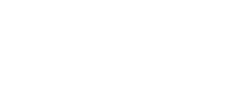
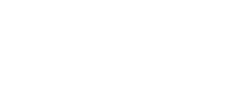
Bancaire & voies d’exécution - 16/10/2025

Tribunal judiciaire de Vannes, jugement du 19 septembre 2024 – RG n° 24/00273 – Juge des contentieux de la protection
Un couple que nous appellerons ici les époux L. s’est retrouvé, sans l’avoir souhaité, engagé dans un prêt personnel de 17 000 euros auprès d'une banque offrant des crédits à la consommation.
Le contexte est celui, malheureusement courant, du rachat de crédit à la consommation souscrit pour financer des panneaux photovoltaïques prétendument avantageux, (rachat de prêt à taux 0%) proposé par un faux intermédiaire financier.
Au départ, le couple est contacté par téléphone, par un escroc dont ils ne savent pas qu'il a récupéré leurs données personnelles et qu'il sait parfaitement qu'ils ont acheté une installation photovoltaïques très chère.
Croyant procéder à un remboursement anticipé de leur crédit initial (souscrit auprès d’un autre établissement pour financer des panneaux photovoltaïques), et se désendetter en souscrivant un prêt à taux 0% dont ils auraient du bénéficier, les époux L. fournissent leurs justificatifs à cette société. (Copie de carte d'identité, Avis d'imposition...etc)
Une somme de 17 000 euros est versée sur leur compte bancaire.
Quelques jours plus tard, cette somme est reversée sur un compte tiers, présenté comme un compte séquestre. (Un RIB leur est adressé)
Mais rapidement, ils constatent deux anomalies majeures : leur ancien crédit continue d’être prélevé, et un nouveau prêt qu’ils affirment ne pas avoir souscrit commence à être remboursé mensuellement.
Confrontés à une situation d’usurpation d’identité et de fraude, ils engagent une procédure judiciaire par l'intermédiaire de notre cabinet d'avocats.
La banque produit un contrat de prêt, signé électroniquement au nom de Monsieur L., pour justifier les prélèvements.
Mais le tribunal constate que :
- La banque ne prouve pas que la signature électronique est qualifiée au sens du règlement européen ;
- Le demandeur prouve qu’il était sur son lieu de travail au moment de la signature ;
- Aucune vérification rigoureuse de l’identité du signataire n’a été opérée par la banque.
Le juge considère que le contrat a été signé par un tiers se faisant passer pour Monsieur L., et que le mécanisme de signature électronique mis en œuvre ne garantit pas la fiabilité exigée par la loi.
En conséquence, le contrat est déclaré inopposable aux demandeurs, ce qui signifie juridiquement qu’ils ne peuvent pas être tenus au paiement de la dette.
Le contrat est censé n’avoir jamais produit d’effets à leur encontre.
L’inopposabilité du contrat entraîne une conséquence juridique claire : aucune somme n’est due par les époux L. au titre de ce prêt.
Dès lors, les prélèvements déjà opérés par la banque doivent être restitués.
Le tribunal condamne la banque à leur rembourser la mensualité déjà prélevée (610,32 euros) et à cesser toute procédure de recouvrement.
Il est important de souligner que le juge ne retient aucun comportement fautif à l’encontre du couple.
Bien au contraire, il reconnaît que les demandeurs ont agi de bonne foi, et qu’ils sont les victimes d’un mécanisme frauduleux orchestré par un tiers.
L’intégralité de la dette est effacée à leur égard.
Le jugement va plus loin en reconnaissant un préjudice moral.
Les époux ont multiplié les démarches pour faire entendre leur situation auprès de la banque, sans obtenir de réponse ni de vérification sérieuse.
Cette inaction a eu pour conséquence leur fichage au FICP, fichier national recensant les incidents de paiement liés au crédit.
Le tribunal estime que cette situation a causé un trouble certain, et condamne la banque à leur verser 5 000 euros au titre de l’atteinte à leurs droits et à leur tranquillité au titre du préjudice moral.
Le Tribunal indemnise également les frais de procédure.
La radiation du FICP est également ordonnée aux frais de la banque, en cohérence avec la déclaration d’inopposabilité du contrat.
Ce jugement met en lumière une stratégie judiciaire très efficace pour protéger les consommateurs victimes de fraudes : l’action en déclaration d’inopposabilité du contrat.
Contrairement à la nullité, qui implique que le contrat a existé mais est rétroactivement effacé, l’inopposabilité signifie que le contrat n’a jamais lié les parties.
Elle est particulièrement pertinente dans les cas d’usurpation d’identité, car elle évite de débattre longuement du consentement ou du vice du consentement : le contrat n’a pas été signé par la personne concernée, point.
C’est aussi un rappel fort adressé aux établissements prêteurs : ils ont l’obligation de s’assurer de l’identité réelle de leurs cocontractants, même dans les démarches dématérialisées.
La signature électronique ne dispense pas de toute vérification.
En cas de manquement, c’est la banque qui en supporte les conséquences juridiques et financières.
Conclusion : une décision protectrice, fondée sur la rigueur juridique
Le jugement du 19 septembre 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Vannes est une illustration claire et structurée de la façon dont le droit protège les victimes d’usurpation d’identité bancaire.
Il rappelle que la charge de la preuve de l’identité du signataire incombe à la banque, et que les consommateurs n’ont pas à prouver l’impossibilité matérielle d’avoir signé un contrat frauduleux. (A rapprocher d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes sur le sujet)
Il souligne aussi que le recours à la signature électronique doit respecter des standards techniques stricts pour avoir une valeur juridique. E
n cas de doute ou de fraude, l’inopposabilité permet d’annuler toutes les conséquences du contrat, sans avoir à démontrer une faute spécifique de l’établissement prêteur.
Maître SALAGNON, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit commercial, droit bancaire, vous conseille, vous assiste et vous accompagne depuis plus de 15 ans sur toute la France concernant vos litiges
Pour le contacter, appelez-le au 02.40.89.00.70, ou prenez contact au moyen du formulaire de contact afin qu’une réponse vous soit apportée dans les meilleurs délais.